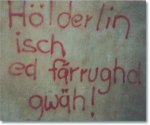 « Il faut s’être promené », écrit Stefan Hertmans, « aux alentours de Tübingen, petite ville du sud de l’Allemagne quelque peu mesquine, pour comprendre comment ce pur exemple mensengèrement heureux de la nature allemande et de la quiétude provinciale a pu faire du poète Friedrich Hölderlin un homme surexcité et furieux – comment la proximité d’une telle clareté l’a pris dans ses filets, l’a ensorcelé avec l’énigme de la vision, cette image d’un monde possible et utopique qui emprunte sa structure au jour de marché du bas Moyen Âge.
« Il faut s’être promené », écrit Stefan Hertmans, « aux alentours de Tübingen, petite ville du sud de l’Allemagne quelque peu mesquine, pour comprendre comment ce pur exemple mensengèrement heureux de la nature allemande et de la quiétude provinciale a pu faire du poète Friedrich Hölderlin un homme surexcité et furieux – comment la proximité d’une telle clareté l’a pris dans ses filets, l’a ensorcelé avec l’énigme de la vision, cette image d’un monde possible et utopique qui emprunte sa structure au jour de marché du bas Moyen Âge.
Toute l’atmosphère désuète et bon enfant de l’université, la proximité brumeuse des forêts sur les collines – qui semble idyllique vue des murs de la ville -, l’odeur pure de futaie qui s’infiltre jusque dans les ruelles étroites à l’aube, l’extraordinaire calme bucolique des bords du Neckar, même en plain midi – bien que tout proche du centre de la vieille ville, on peu y jouir du calme et de la solitude comme en plein bois – tout cela donne l’illusion que quelque chose de ce que Proust nommait le temps perdu du vécu paradiasiaque peut encore être conservé, peut être prolongé dans notre époque, où l’on peut encore faire la dernière partie du trajet de Stuttgart à cette petite ville champêtre dans un petit omnibus poussif, au milieu des bois aux sentiers sablonneux, qui défilent comme autant d’invitations à prendre congé de sa vie et à commencer autre chose, quelque chose de vain, et par là de magnétisant et de grotesque. »
(in: Entre villes)
Après que Paul Celan avait noté un poème dans le livre d’or de la tour – Tübingen, Jänner – voici Friedericke Mayröcker, qui en 2008 a écrit 40 poèmes dans les pas de Scardanelli.
mit Scardanelli
im Grunde deines Mundes, damals
wann weisz die Schwalbe dasz es Frühling
wird nachts nadelst du als Regen an mein Fenster ich
liege wach ich denke an die Nachmittage umschlungenen
Mitternächte, vor vielen Jahren diese Rosenkugeln die
Schaafe auf der dunklen Himmels Weide
ZUGABE/RAPPEL de lyrikline :
etwas Kinder / oder / mehr ist nicht zu sagen / oder Versuch Inger Christensen und Andrea Zanzotto miteinander verknüpfend
Halbseide von Amsel halbseidene Amsel
und mit LAKOSTE im Arm weiches Bindegewebe
rosafarben der Küchenboden vielleicht
Spiegelung einer Himmelsfarbe
Herzkirschen auf einem Teller
der auf der Anrichte steht oder auf einem der leeren Töpfe
weil die Anrichte vollgeräumt ist
und Knistern Tropfgeräusche Haar-Urwald
einzelne Haare klebend an den Handinnenflächen
im Waschbecken zwischen den Brüsten an den Fußsohlen
im Innern eines Pantoffels
und wie Stelzen die Beine dürr und nackt
und der linke Daumen mit dem eingezogenen
Dorn oder Schiefer am Morgen schmerzt
das Spucken das Rülpsen das Masturbieren
die Sprüche oder Maximen am Morgen
oder daß man in der Unterführung (in den Verliesen)
wo man vor dem Regen geschützt ist
nicht weiß was man nun mit dem aufgespannten Schirm tun soll
ob man ihn abspannen soll oder wie ein
Sonnenrad vor sich her drehen soll
(Päderast oder Kampfbonbon)
oder daß der bläuliche Leib einer Fliege
sich im gleichen Zeitmaß mit den gegen das Heckfenster
des Straßenbahnwagens fließenden Regentropfen
abwärts bewegt und man ihre durchsichtige Unterseite
erblicken kann ehe sie abhebt
(getrocknete Mutter)
und ein Mädchenlachen im Hintergrund
des Straßenbahnwagens Beethovens Schicksalssymphonie intoniert
und man die Uhrzeit abzulesen versucht
indem man geistesabwesend auf den Kalender blickt
oder verschiedene Hügelbewegungen / Wandergitarre
oder die blutige Arztmanschette im Fenster
quelque part des enfants / ou / rien d’autre à dire /
ou essai combinant Inger Christensen
avec Andrea Zanzotto
demi-soie d’alouette, alouette mi-soyeuse
et LACOSTE au bras tendre tissu conjonctif
sol rose de la cuisine peut-être
réflexion d’une couleur du ciel
cœurs-cerises dans une assiette
posée sur la desserte ou sur une casserole vide
maintenant que la desserte est désencombrée
cliquètement bruit de gouttes chevelure-jungle
quelques poils collent aux paumes
dans l’évier entre les seins à la plante des pieds
à l’intérieur d’une pantoufle
comme des échasses les jambes amaigries nues
et le pouce gauche percé
d’une épine ou éclat d’ardoise le matin fait mal
cracher roter masturber
les sentences et maximes du matin
ou alors que dans le passage souterrain (dans les cachots)
où l’on est protégé de la pluie
on ne sait que faire du parapluie ouvert
doit-on le replier ou le
braquer tournoyant comme une roue solaire
(pédéraste ou bonbon de combat)
ou que le corps bleuâtre d’une mouche
avec le même rythme temporel qu’une goutte
de pluie sur la vitre arrière d’un wagon de tram
se déplace à reculons on aperçoit son abdomen
translucide avant qu’elle ne s’envole
(mère asséchée)
et un rire de jeune fille à l’arrière
du tram entonne la Symphonie du Destin de Beethoven
on essaie de lire l’heure
en regardant distraitement le calendrier
ou diverses ondulations de collines / guitare de randonnée
ou la manchette sanglante du médecin à la fenêtre
Voir plus de Friedericke Mayröcker ? C’est sur Poezibao – anthologie permanente et Lyrikline


 « Il existe une légende, celle d’un musicien ambulant aveugle, appelé Hoichi. En s’accompagnant d’un instrument à cordes, le biwa, Hoishi contait l’histoire de la dynastie des Heike, chassés du pouvoir au douzième siècle par la dynastie des Genji et pour la plupart exterminés. Un jour, un moine lettré entendit par hasard Hoichi chantant dans la rue. Les gens du petit peuple qui composaient son public l’écoutaient, fascinés. Quand arriva le moment le plus captivant, ils furent nombreux à pleurer. Le moine s’éprit d’Hoichi et le conduisit dans son temple. Il lui offrit une chambre et des repas, en échange de quoi Hoichi devait habiter là et ne chanter dorénavant que pour lui. Hoichi était content de plus affronter la faim ni le froid. Quant au petit peuple, qui n’entendrait plus la voix d’Hoichi, il fut déçu. Mais il y avait encore un autre groupe d’auditeurs auquel Hiochi manquait : les esprits de la dynastie des Heike. Trois groupes de récepteurs se font ici concurrence : le peuple qui aimait la voix d’Hoichi, le moine, qui, pour savoure l’art ‘pur’ d’Hiochi, vient en aide à l’artiste grace à son argent et à son pouvoir, et les esprits des morts auxquels la voix d’Hiochi permettait de demeurer dans la mémoire collective. Toutes les nuits, les esprits enlevaient Hiochi, l’emmenaient dans leur cimetière et l’obligeaient de chanter pour eux. Quand le moine s’aperçut des ces enlèvements, il fit écrire sur la peau d’Hiochi un texte de prière le protégeant des esprits. Finalement, son corps tout entier fut couvert de signes sacrés, mais ceux qui étaient chargés d’écrire le texte avaient oublié d’écrire sur les oreilles. La nuit venue, les morts apparurent, ils s’étonnèrent de ne pas voir Hoichi, ils ne virent que ses oreilles. Ils crièrent le nom d’Hoichi mais ne reçurent pas de réponse. Ils finirent par lui arracher les oreilles avant de les emporter. Hoichi serra les dents, il ne cria pas et resta assis sans bouger dans l’obscurité.
« Il existe une légende, celle d’un musicien ambulant aveugle, appelé Hoichi. En s’accompagnant d’un instrument à cordes, le biwa, Hoishi contait l’histoire de la dynastie des Heike, chassés du pouvoir au douzième siècle par la dynastie des Genji et pour la plupart exterminés. Un jour, un moine lettré entendit par hasard Hoichi chantant dans la rue. Les gens du petit peuple qui composaient son public l’écoutaient, fascinés. Quand arriva le moment le plus captivant, ils furent nombreux à pleurer. Le moine s’éprit d’Hoichi et le conduisit dans son temple. Il lui offrit une chambre et des repas, en échange de quoi Hoichi devait habiter là et ne chanter dorénavant que pour lui. Hoichi était content de plus affronter la faim ni le froid. Quant au petit peuple, qui n’entendrait plus la voix d’Hoichi, il fut déçu. Mais il y avait encore un autre groupe d’auditeurs auquel Hiochi manquait : les esprits de la dynastie des Heike. Trois groupes de récepteurs se font ici concurrence : le peuple qui aimait la voix d’Hoichi, le moine, qui, pour savoure l’art ‘pur’ d’Hiochi, vient en aide à l’artiste grace à son argent et à son pouvoir, et les esprits des morts auxquels la voix d’Hiochi permettait de demeurer dans la mémoire collective. Toutes les nuits, les esprits enlevaient Hiochi, l’emmenaient dans leur cimetière et l’obligeaient de chanter pour eux. Quand le moine s’aperçut des ces enlèvements, il fit écrire sur la peau d’Hiochi un texte de prière le protégeant des esprits. Finalement, son corps tout entier fut couvert de signes sacrés, mais ceux qui étaient chargés d’écrire le texte avaient oublié d’écrire sur les oreilles. La nuit venue, les morts apparurent, ils s’étonnèrent de ne pas voir Hoichi, ils ne virent que ses oreilles. Ils crièrent le nom d’Hoichi mais ne reçurent pas de réponse. Ils finirent par lui arracher les oreilles avant de les emporter. Hoichi serra les dents, il ne cria pas et resta assis sans bouger dans l’obscurité. « Dans un lent mouvement continu – descendant ou montant – nous faisons connaissance avec les puissants. Mais ils ne sont jamais plus terribles que lorsqu’ils s’élèvent de la plus profonde dégradation, celle des pères. Le père sénile et hébété que le fils vient de coucher avec tendresse, à qui il vient de dire : ‘Sois tranquille, tu es bien couvert’, s’écrie : ‘Non !’ en sorte de réponse bouscula la question ; il repoussa la couverture avec tant de force qu’elle se déploya d’un coup, en un instant, et il se dressa sur le lit, d’une seule main touchant légèrement le plafond : ‘Tu voulais me couvrir, je le sais, mauvais garnement ! Mais je ne suis pas encore couvert ! Et c’est aussi la dernière force, assez pour toi, trop pour toi ! (…) Heureusement un père n’a besoin de personne pour percer à jour son fils.’ (…) Et il se tenait debout, parfaitement libre, jetant les jambes. Il rayonnait d’intelligence. (…) ‘Ainsi tu sais à présent ce qu’encore il y avait hors de toi, jusqu’ici tu ne connaissais que toi-même. Oui tu étais bien un enfant innocent, mais plus encore un homme diabolique.’
« Dans un lent mouvement continu – descendant ou montant – nous faisons connaissance avec les puissants. Mais ils ne sont jamais plus terribles que lorsqu’ils s’élèvent de la plus profonde dégradation, celle des pères. Le père sénile et hébété que le fils vient de coucher avec tendresse, à qui il vient de dire : ‘Sois tranquille, tu es bien couvert’, s’écrie : ‘Non !’ en sorte de réponse bouscula la question ; il repoussa la couverture avec tant de force qu’elle se déploya d’un coup, en un instant, et il se dressa sur le lit, d’une seule main touchant légèrement le plafond : ‘Tu voulais me couvrir, je le sais, mauvais garnement ! Mais je ne suis pas encore couvert ! Et c’est aussi la dernière force, assez pour toi, trop pour toi ! (…) Heureusement un père n’a besoin de personne pour percer à jour son fils.’ (…) Et il se tenait debout, parfaitement libre, jetant les jambes. Il rayonnait d’intelligence. (…) ‘Ainsi tu sais à présent ce qu’encore il y avait hors de toi, jusqu’ici tu ne connaissais que toi-même. Oui tu étais bien un enfant innocent, mais plus encore un homme diabolique.’


